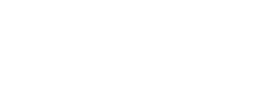Un rapport, parlementaire se penche sur l’intelligence artificielle au travail. Ses auteurs, les députés Emmanuelle Hoffin (Ensemble pour la République) et Antoine Golliot (Rassemblement national), qui appartiennent à la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, abordent de nombreux aspects parmi lesquels le dialogue social autour de ces nouvelles technologies (pour ses aspects formation, lire cette brève du 3 octobre 2025).
Le droit outille, en théorie, les représentants du personnel pour s’emparer du sujet de l’introduction dans une entreprise d’outils d’intelligence artificielle, dont les effets sur les risques professionnels doivent être inclus dans le document unique d’évaluation des risques professionnels, le Duerp, explique le rapport.
Le rapport cite ces points précis :
- le CSE doit être informé et consulté sur l’introduction de nouvelles technologies (article L.2312-8 du code du travail), l’instance pouvant recourir à un expert habilité (article L.2315-94). ;
- le CSE doit être informé préalablement à la mise en place de moyens de contrôle de l’activité des salariés, de méthodes ou techniques d’aide au recrutement des candidats à un emploi (article L.2312-37 et L.2312-38) ;
- la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP) peut aborder les changements induits par les usages de l’IA (article L.2242-20). Cette négociation peut aborder la question des emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques (article L.2242-2).
A ces dispositions s’ajoutent des modes de consultation propres à certaines entreprises comme des « groupes de travail IA », « comité IA » ou autre « commission mixte de gouvernance du numérique ».
Malgré ces éléments de droit prévus par le code du travail, dans les faits, « rien n’assure (..) que le fonctionnement des entreprises garantisse l’exercice, par les salariés, d’un droit collectif à l’information et à la consultation sur les modalités et les effets d’un développement des usages de la technologie ».
Cette incertitude, poursuit le rapport, pose avant tout le problème « du caractère opérant des procédures de saisine des instances représentatives du personnel et du champ de la négociation collective ». C’est d’ailleurs bien la raison des contentieux qui se développent, certains CSE, comme celui de France Télévisions, obtenant la condamnation de leur employeur pour absence de consultation de l’instance.
Les parlementaires déplorent dans la foulée « l’absence de dynamique dans le champ des négociations collectives », l’absence d’un véritable dialogue social portant sur l’impact de l’IA sur l’activité de production. « Il n’existe aucun accord de branche quant à l’usage de l’IA et le nombre d’accords d’entreprise demeure insignifiant », peut-on lire dans le rapport.
Le développement des technologies IA « ne figure parmi les thèmes abordés par les partenaires sociaux que de manière sectorielle et extrêmement marginale », constatent les auteurs.
Les rapporteurs se prononcent pour la conclusion d’un accord national interprofessionnel (ANI) et d’accords de branche « susceptibles de donner un cadre au développement de l’intelligence artificielle ». Les députés imaginent « un instrument de droit souple » qui permettrait « de créer des instruments d’évaluation de l’impact de la technologie sur chaque métier et à mettre en place les formations adéquates ».
Une méthodologie déjà suggérée par l’accord cadre européen du 22 juin 2020 sur la transformation numérique des entreprises : « Ce texte fournit une méthodologie pour appréhender les transformations de l’entreprise et du travail qui pourrait servir de fondement à un volet du dialogue social spécialement consacré aux usages de l’intelligence artificielle ».
L’autre recommandation des députés a directement trait à la consultation du CSE et aux contentieux que son absence génère.
Il s’agit « d’expliciter dans la loi l’obligation d’engager des procédures d’information et, le cas échéant, de consultation des instances représentatives du personnel dès l’engagement des projets reposant sur l’introduction de procédés technologiques appuyés sur l’IA, y compris au stade expérimental ».
Cette recommandation découle du constat largement établi par les syndicats et les élus : la saisie des IRP est très inégale selon les employeurs, certains estimant que la mise en place d’une IA dans l’organisation ne relève que de leurs prérogatives sans avoir à en rendre compte. « De surcroît, ajoutent les députés, la mise en oeuvre des procédures de consultation n’offre pas la faculté de mener une revue au long cours du développement des usage de l’IA : le rythme de déploiement effectif des outils conduirait à ce que l’avis rendu par les instances ne porte que sur les principes et objectifs, sans garantie d’un réexamen de ses effets pratiques dans les réunions ultérieures ».
Il serait donc utile, estiment les députés, de s’assurer que les IRP sont saisies « dès l’engagement d’un projet d’IA ». Comment ? En s’inspirant des décisions judicaires récentes selon lesquelles un projet d’introduction de l’IA justifie à lui seul la consultation du CSE et le recours à un expert, sans qu’il ne soit plus besoin de démontrer des répercussions sur les conditions de travail. En l’état actuel des textes, ces décisions de première instance peuvent en effet être confirmées ou infirmées par la Cour de cassation, surtout si l’employeur argue qu’il s’agit d’une expérimentation.
Par ailleurs, le rapport plaide pour l’inscription de l’introduction de nouvelles technologies dans la liste des thèmes relevant des négociations devant être engagées chaque année (salaires, temps de travail, partage de la valeur, égalité professionnelle, qualité de vie au travail, etc.).
Les députés souhaiteraient donc voir complété l’article L.2242-13 du code du travail, mais ils envisagent aussi l’utilité de mentionner explicitement l’introduction des nouvelles technologie dans le champ de la consultation du CSE sur les orientations stratégiques (article L.2312-14).