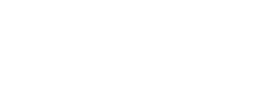La modération reste de mise dans les entreprises françaises. Après une année 2024 marquée par un reflux de l’inflation, les DRH maintiennent leur prudence en matière d’augmentations salariales. Selon l’Observatoire de la rémunération du cabinet LHH, publié le 2 septembre, l’enveloppe budgétaire consacrée aux hausses de salaire n’a pas dépassé 2,1 % en 2025, un niveau inférieur aux prévisions de janvier qui tablaient sur 2,8 %.
Cette tendance se confirme dans d’autres études. Le cabinet Deloitte, qui s’appuie sur un panel de 300 entreprises (plus d’un millions de données individuelles) observe des augmentations de 2,5 % pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise (OETAM) – soit une baisse d’un point par rapport à l’année précédente – et de 2,3 % pour les cadres, en recul de 1,1 point.
« La baisse des enveloppes budgétaires n’est pas une surprise avec la réduction de l’inflation dans un environnement marqué par des incertitudes multiples », analyse Delphine Landeroin, spécialiste des politiques de rémunération chez LHH. L’experte pointe notamment les finances publiques sous tension, la pression réglementaire croissante et les attentes sociales fortes qui pèsent sur les entreprises.
Cette prudence marque un retour aux niveaux d’avant la crise sanitaire, avant que l’inflation des années 2022-2023 ne contraignent les employeurs à des gestes salariaux plus généreux. Et rien ne laisse présager un changement de cap pour 2026 : seules 40 % des entreprises ont établi des budgets prévisionnels, d’après Deloitte. Avec à la clef, des enveloppes de 2 % en moyenne.
L’étude LHH, qui s’appuie sur un panel de 200 entreprises représentant 1,3 million de salariés, montrent que les DRH adaptent leurs pratiques, en optant pour la différenciation.
En 2025, les hausses individuelles dominent pour les cadres – 55 % des entreprises y ont exclusivement recours cette année, contre 51 % en 2024 -, tandis que les mesures collectives restent privilégiées pour les OETAM bien qu’en recul (22 % des entreprises optent pour des hausses uniquement individuelles, contre 34 % l’année dernière).
Parallèlement, la rémunération variable gagne du terrain chez les OETAM : 78 % d’entre eux en ont bénéficié cette année, contre 59 % en 2024, soit une progression de 19 points. Au total, 30 % des entreprises ont mis en place un système de rémunération variable en 2025.
La prime de partage de la valeur, en revanche, perd de son attrait. Soumise depuis fin 2023 à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux pour les entreprises de plus de 50 salariés, elle n’a été utilisée que par moins d’un quart des employeurs, pour un montant médian de 400 euros, selon Deloitte. Par catégorie, les cadres touchent 880 euros, les OETAM, 300 euros.
Autre mesure : les entreprises ont porté une attention particulière aux salariés les moins bien rémunérés. Près d’une société sur deux a prévu des hausses plus importantes pour les premières tranches de rémunération tandis qu’un quart a revu ses grilles internes ou instauré des minima salariaux.
Les DRH développent également des stratégies d’optimisation via les « packages salariaux » : 50 % ont augmenté leur participation aux frais de repas et 30 % ont renforcé leur soutien au transport, autant de leviers qui permettent d’améliorer le pouvoir d’achat sans impact direct sur la masse salariale.
Au-delà, les entreprises doivent désormais intégrer une nouvelle contrainte : la future transposition de la directive européenne sur la transparence salariale, attendue pour juin 2026. Le texte européen ne se contente pas de viser la réduction des inégalités entre les sexes. Il impose à chaque employeur de démontrer, preuves à l’appui, que deux salariés occupant des postes de valeur équivalente perçoivent une rémunération comparable. Une exigence qui bouleverse les pratiques établies et contraint les entreprises à justifier objectivement chaque écart de salaire.
Or, les écarts persistent aujourd’hui : selon Deloitte, ils s’élèvent à 1,4 % en faveur des hommes pour les OETAM et à 3 % pour les cadres, avec des disparités plus marquées aux niveaux hiérarchiques supérieurs (10,2 % pour les cadres supérieurs contre 2,5 % pour les premiers niveaux).
Un tiers des entreprises ont déjà prévu des budgets dédiés à la correction de ces inégalités, avec un taux médian de 0,2 %. Près d’une société sur deux a engagé un diagnostic interne pour évaluer ses pratiques. « Cette année plus que jamais, les entreprises ont tout intérêt à poursuivre leurs efforts pour l’égalité salariale femmes-hommes mais aussi plus largement en cherchant à objectiver plus formellement l’ensemble des pratiques », souligne Delphine Landeroin.
Le projet de loi français devrait être adopté d’ici la fin de l’année, après de nouvelles séances de négociation avec les partenaires sociaux prévues les 4 et 9 septembre. Les décrets d’application suivraient entre fin 2025 et début 2026, pour une entrée en vigueur effective en 2027.