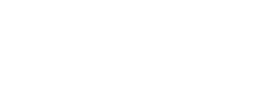Par un arrêt du 10 septembre 2025 destiné à la publication au Bulletin des chambres civiles et à son rapport annuel, la Cour de cassation met fin à sa jurisprudence déniant au salarié qui tombe malade au cours de ses congés payés le droit de prendre ultérieurement le congé dont il n’a pas pu bénéficier du fait de son arrêt de travail. Désormais, un salarié en arrêt maladie pendant ses congés a droit à ce qu’ils soient reportés dès lors que l’arrêt est notifié à l’employeur.
L’affaire soumise à la Cour lui donne également l’occasion de se prononcer sur le point de départ de la prescription d’une action de l’employeur en répétition de l’indemnité de congé payé versée indûment.
Une construction jurisprudentielle…
Jusqu’à ce revirement, le salarié qui tombait malade pendant ses congés payés ne bénéficiait pas d’un report des jours de congé coïncidant avec la période de maladie, l’employeur s’étant acquitté de son obligation à son égard (arrêt du 4 décembre 1996).
► Selon la jurisprudence, le salarié malade au cours de ses congés cumule son indemnité de congé payé calculée normalement et les indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS) (arrêt du 26 novembre 1964). En revanche, l’employeur ne verse pas d’indemnité complémentaire de maladie en complément des prestations de la sécurité sociale (arrêt du 2 mars 1989) sauf dispositions plus favorables. La question se pose de savoir si ces solutions continueront de s’appliquer dans le cas où le salarié n’envoie pas son arrêt de travail à l’employeur et ne sollicite donc pas le report des congés payés coïncidant avec la période de maladie.
… contraire au droit européen
La solution était contraire au droit européen, qui érige le droit au congé annuel au rang des principes essentiels du droit social de l’Union (CJUE 6 nov. 2018 aff. 569/16 et 570/16) et qui distingue la finalité du droit au congé annuel payé de celle de la maladie. Celle du congé annuel est de permettre au salarié de se reposer et de disposer d’une période de détente et de loisirs tandis que celle du congé de maladie est de lui permettre de se rétablir d’une maladie engendrant une incapacité de travail (CJUE 20 janvier 2009 aff. 350/06 ; CJUE 10 septembre 2009 aff. 277/08). Le droit européen s’oppose à la perte du droit à congé lorsqu’une incapacité de travail survient pendant une période de congé annuel fixée au préalable (CJUE 21 juin 2012 aff. 78/11).
Ce revirement était attendu et permet à la France de se mettre en conformité avec le droit européen alors qu’elle a fait l’objet d’une mise en demeure par la Commission européenne de s’expliquer et de remédier à ce manquement aux règles de l’UE sur le temps de travail en juin 2025.
► La solution était remise en cause à la fois par la cour d’appel de Versailles, dont l’arrêt n’avait pas fait l’objet d’un pourvoi (cour d’appel de Versailles, 18 mai 2022 no°19/03230), et par le ministère du travail, qui, depuis 2024, conseille aux entreprises de ne plus appliquer la jurisprudence du 4 décembre 1996 afin « d’éviter tout contentieux inutile », mais de s’inspirer de la jurisprudence de la cour d’appel de Versailles et d’appliquer aux congés reportés les règles de report issues de la loi du 22 avril 2024, conseil renouvelé sur son site internet le 17 septembre 2025.
En l’espèce, une salariée médecin du travail travaille à temps partiel les mardis toute la journée et jeudis matin, soit 1,5 jour hebdomadaire ; elle dispose de l’ensemble des vacances scolaires en contrepartie de vacations complémentaires pour son employeur. Après son départ en retraite au 31 décembre 2016, la salariée saisit le 9 mai 2017 le conseil de prud’hommes d’une demande d’heures complémentaires. Mais au cours de l’instance, l’employeur constate qu’il a mal décompté les congés payés de l’intéressée et a indemnisé un nombre excédentaire de jours de congé. Il forme une demande reconventionnelle le 19 mars 2018 limitée aux périodes de prise de congés qui étaient en cours pendant les trois années précédant la rupture (du 1er juin 2013 au 31 mai 2014, à hauteur de 46 jours excédentaires, du 1er juin 2014 au 31 mai 2015, de 45 jours, du 1er juin 2015 au 31 mai 2016, de 47 jours, du 1er juin 2016 au 31 décembre 2016, de 33 jours). La salariée est condamnée à lui payer plus de 58 000 euros en remboursement de congés excédentaires et interjette appel.
Le salarié en arrêt pendant ses congés peut bénéficier ultérieurement des jours de congé coïncidant avec la maladie…
Après avoir rappelé les termes de l’article L.3141-3 du code du travail (« Le salarié a droit à un congé de 2,5 jours par mois de travail effectif chez le même employeur ») et sa jurisprudence du 4 décembre 1996, la chambre sociale convoque la jurisprudence européenne.
Puis elle énonce qu’il convient de juger désormais qu’il résulte de l’article L.3141-3 précité, interprété à la lumière de l’article 7, § 1 de la directive 2003/88 du 4 novembre 2003, que le salarié en situation d’arrêt de travail pour cause de maladie survenue durant la période de congé annuel payé a le droit de bénéficier ultérieurement des jours de congé payé coïncidant avec la période d’arrêt de travail pour maladie.
… s’il a notifié l’arrêt maladie à son employeur
La chambre sociale approuve la cour d’appel d’avoir jugé que les jours d’arrêt de travail ne pouvaient pas s’imputer sur le solde de congés payés après avoir constaté que les arrêts de travail avaient été notifiés à l’employeur. Elle conditionne ainsi le bénéfice du report à l’obligation d’avoir notifié l’arrêt maladie à l’employeur.
► 1. Dans son communiqué, la Cour de cassation confirme que le report des congés suppose que l’arrêt maladie soit « notifié » à l’employeur. 2. L’interprétation du code du travail conforme au droit européen s’applique dès maintenant aux litiges en cours (arrêt du 10 avril 2013).
Cette solution soulève de nombreuses questions nouvelles qui seront examinées par les juridictions du fond. Nous évoquons ci-après quelques-unes de ces questions et proposons des éléments de réflexion.
► L’arrêt de revirement pose le principe du report des congés payés si un arrêt de travail est notifié, sans tirer les conséquences de cet événement sur la gestion de la paie. Dans l’attente de précisions ou conditions ajoutées par la jurisprudence, la notification de l’arrêt de travail suffit à générer un droit au report, que cet arrêt donne lieu à indemnisation ou non.
Quelles sont les conséquences de la notification d’un arrêt de travail ?
L’arrêt de travail notifié suspend le contrat de travail même si le salarié est en congé payé.
► On peut supposer que la période de congé payé est elle-même suspendue pour la durée de l’arrêt maladie. A l’issue de l’arrêt maladie, soit la durée de congé posée n’est pas expirée et alors le salarié est en congé jusqu’au terme initial, soit elle est expirée et le salarié reprend le travail. On peut également supposer que la solution s’applique à la maladie survenue indifféremment pendant les quatre semaines du congé principal, la 5e semaine ou un congé conventionnel. En revanche, la question reste à examiner s’agissant des RTT, des jours de récupération, etc.
Si l’arrêt maladie a été notifié à la sécurité sociale dans les 48 heures et à l’employeur dans les délais légaux ou conventionnels, se met alors en place l’indemnisation de la période de maladie dont les modalités dépendent des choix de l’employeur (subrogation dans les droits du salarié aux IJSS ou non), de l’ancienneté du salarié et des dispositions conventionnelles.
► 1. L’assuré doit envoyer à sa CPAM les volets 1 et 2 de l’arrêt de travail dans les 48 heures (article R.321-2 du code de la sécurité sociale) pour le bénéfice des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS), procédure remplacée le plus souvent par la télétransmission. Le bénéfice du complément légal à la charge de l’employeur suppose d’avoir justifié de l’incapacité de travail dans les 48 heures (article L.1226-1 du code du travail). 2. Pour mémoire, les IJSS sont versées après un délai de carence de trois jours et le complément légal à la charge de l’employeur à partir du 8e jour d’arrêt. Il est probable que certains salariés renonceront à notifier leur arrêt de travail s’il en découle une perte de revenus.
L’employeur doit alors régulariser la paie, informer le salarié et appliquer, selon nous et comme le ministère du travail le préconise, les dispositions du code du travail relatives au droit au report des congés payés :
- faire un signalement DSN d’arrêt de travail ;
- recalculer l’indemnité de congé payé et, en cas de trop-versé, retenir la part d’indemnités correspondant aux jours de congé payé coïncidant avec la période de maladie ;
- opérer le maintien de salaire, s’il y a lieu, après décompte du délai de carence éventuel ;
- calculer le nombre de jours de congé payé reportés et informer le salarié, dans le mois suivant sa reprise, du nombre de jours de congé dont il dispose et de la date jusqu’à laquelle ces jours de congé peuvent être pris (article L.3141-19-3 du code du travail) ; en application des règles de report des congés payés issues de la loi du 22 avril 2024, si la période de prise des congés est en cours, l’employeur pourrait imposer la prise des congés reportés sous réserve de respecter le délai de prévenance d’un mois. Si la période est expirée ou ne permet pas de solder l’intégralité du reliquat de congés payés acquis, le salarié bénéficie d’une période de report de 15 mois débutant à réception de l’information (article L.3141-19-1 du code du travail) ;
- penser à tenir compte de cet arrêt de travail dans le calcul des congés payés de la période d’acquisition en cours puisqu’il donne droit à congés payés à raison de 2 jours ouvrables par mois au lieu de 2,5.
Et si le salarié tombe malade pendant ses vacances à l’étranger ?
Si l’arrêt maladie survient dans un Etat membre de l’UE, le salarié peut percevoir les IJSS en application des règlements communautaires. Il en va de même dans les autres pays si une convention internationale le prévoit. L’arrêt de travail prescrit par le médecin étranger devrait donc pouvoir être valablement notifié à l’employeur et emporter droit au bénéfice ultérieur des congés.
En dehors de ces deux cas, le salarié ne peut pas percevoir les IJSS tant qu’il est à l’étranger (arrêt du 10 avril 2008 ; arrêt du 5 juin 2025). Mais il peut pour autant disposer d’un arrêt de travail prescrit en bonne et due forme. En application de la décision du 10 septembre 2025, si le salarié notifie l’arrêt à l’employeur, il ne percevra ni IJSS ni complément de salaire ni indemnité de congé payé, mais il pourra reporter ses congés payés. Evidemment, le salarié bénéficiera des IJSS à son retour en France si un arrêt maladie lui est prescrit.
Quelle application rétroactive de cette jurisprudence ?
La solution s’applique rétroactivement aux situations passées sous réserve que le salarié ait notifié à l’employeur les arrêts maladie survenus pendant les congés.
Se pose alors la question de la prescription et du point de départ de l’action du salarié. S’agissant de l’action du salarié, il convient de distinguer selon que le contrat est en cours ou bien rompu. Dans le premier cas, le délai de prescription applicable à l’exercice en nature du droit à congés payés est biennal. Dans le second cas, le délai est triennal car il s’agit d’une action en paiement du salaire et son point de départ est fixé à l’expiration de la période de prise des congés payés si l’employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement (arrêt du 13 novembre 2023).
► 1. Par hypothèse, l’employeur qui s’est vu notifier un arrêt de travail avant la décision du 10 septembre 2025 aura le plus souvent appliqué la jurisprudence antérieure : le salarié aura cumulé l’indemnité de congé payé et les IJSS mais l’employeur ne lui aura pas accordé le report de ses congés payés. Le salarié pourra-t-il plaider que l’employeur ne lui a pas permis de prendre les congés reportés auxquels il avait droit et a donc été défaillant ? Dans ce cas, l’employeur ne pourrait pas soulever la prescription de l’action du salarié. 2. La question se pose également d’identifier les créances réciproques : le salarié malade pendant ses congés aurait dû percevoir, en plus des IJSS, le complément de salaire patronal (non perçu sauf dispositions conventionnelles plus favorables) et non pas l’indemnité de congé payé. Si les congés payés sont reportés, l’employeur devra-t-il indemniser une seconde fois les congés sur le fondement du maintien de salaire ? Ou bien pourra-t-il demander la compensation entre les indemnités versées ou agir en répétition de l’indemnité de congé versée ? Autant de questions que soulève la solution issue de l’arrêt du 10 septembre 2025.
Par ailleurs, l’affaire soumise à la chambre sociale de la Cour de cassation lui permet de trancher une autre question inédite, celle du point de départ de la prescription d’une action en répétition de l’indemnité de congé payé versée indûment par l’employeur. En l’espèce, l’employeur avait indemnisé un nombre de jours de congé payé excédentaire.
La Cour de cassation rappelle que cette action, qui a la nature d’une créance salariale, est soumise à la prescription triennale de l’article L.3245-1 du code du travail. Puis elle énonce que son point de départ est le jour du paiement de l’indemnité si, à cette date, l’employeur était en mesure de déceler le paiement indu et d’en demander la restitution.
► L’employeur est en mesure de savoir, à réception de l’arrêt de travail, que l’indemnité de congé payé n’est pas due au titre des jours de maladie.
Dans l’affaire commentée, le contrat de travail étant rompu, la demande de l’employeur portait sur les trois années précédant la rupture du contrat de travail.
► La première avocate générale expose dans son avis que « l’employeur peut réclamer les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat intervenue le 31 décembre 2016, en sorte que seules les éventuelles prétentions portant sur des congés payés exigibles avant le 31 décembre 2013 sont prescrites ».