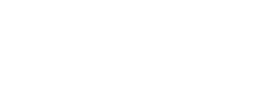Les cadres français ne sont pas réfractaires aux grandes mutations du travail. Bien au contraire, ils veulent y prendre toute leur part. C’est l’un des principaux enseignements d’une vaste étude prospective menée par l’Apec sur « les futurs du travail » à l’horizon 2030, dont les résultats ont été dévoilés, hier, lors d’un colloque réunissant partenaires sociaux et experts.
Basée sur une enquête auprès de 2 000 cadres et de 1 000 entreprises, complétée par des entretiens en région, cette réflexion identifie cinq « chocs majeurs » qui structureront le monde du travail dans les années à venir : la transformation du rapport au travail, les révolutions technologiques, la transition écologique, le vieillissement de la population active et l’évolution des postures face à la diversité et l’inclusion.
Quelque 85 % des cadres considèrent que le monde du travail a connu des transformations importantes ces dix dernières années, et 77 % anticipent qu’il en sera de même dans la décennie à venir. Une perspective partagée par 55 % des entreprises.
La transformation numérique arrive en tête des facteurs de changement (90 %), suivie par l’évolution du rapport au travail (83 %) et le vieillissement de la population (81 %). La transition écologique, bien que jugée importante, arrive en dernière position (72 %).
« Les cadres ont une conscience aiguë des transformations, explique Laetitia Niaudeau, directrice générale adjointe de l’Apec. Mais ces perceptions ne sont pas homogènes. La transformation numérique est considérée comme le facteur majeur, déjà très avancée, qui s’est imposée sans projet collectif. Les cadres disent : « on se débrouille, on fait avec » ».
Le changement du rapport au travail constitue une mutation profonde. La généralisation du télétravail y a largement contribué : cette pratique, largement répandue depuis la crise sanitaire, concerne désormais deux cadres sur trois de manière régulière. Elle est devenue une dimension centrale des conditions de travail et de l’attractivité des postes.
Ces nouvelles conditions ont entraîné des transformations managériales notables : 80 % des cadres estiment que les pratiques managériales ont évolué ces dernières années, et 57 % pensent que le management va encore connaître des changements importants. Pour autant, le travail reste une dimension particulièrement importante : plus de la moitié jugent qu’il occupe une place très importante dans leur vie.
L’IA s’impose progressivement dans le quotidien professionnel : 35 % des cadres l’utilisent sur une base hebdomadaire, et 75 % estiment que ce sera une compétence importante pour exercer leur métier à l’avenir. Surtout, ils sont de plus en plus nombreux à juger que le développement de l’IA aura un impact sur leur métier (48 %, +18 points en deux ans).
L’appréhension cède progressivement la place à l’opportunité : 37 % considèrent l’IA comme une chance (+15 points en deux ans), même si 42 % restent nuancés, y voyant à la fois une opportunité et une menace. Résultat : en juin 2025, 79 % déclarent vouloir se former à l’IA, soit 19 points de plus qu’en janvier 2024, un souhait qui concerne toutes les catégories, juniors comme seniors.
Malgré un « backlash » récent, une majorité de cadres estiment toujours que la transition écologique aura un impact important sur leur métier (55 %, -9 points en deux ans). À titre individuel, 64 % aimeraient être formés sur le sujet, un souhait particulièrement marqué chez les moins de 35 ans (76 %).
Laetitia Niaudeau note une « dissonance entre leurs convictions personnelles et leur entreprise ». Certains cadres ont fait part de leur inquiétude face à des normes « mal adaptées à la réalité des métiers ».
Le vieillissement de la population active reste un défi majeur. Actuellement, 37 % des cadres seniors se sont déjà sentis pénalisés dans leur évolution professionnelle du fait de leur âge, et la mobilité professionnelle constitue toujours un risque à leurs yeux.
Les visions divergent selon la taille des entreprises : 76 % des grandes structures considèrent que l’évolution démographique sera structurante, contre seulement 54 % des PME et 55 % des TPE.
Alors que les politiques de diversité, d’équité et d’inclusion sont remises en cause outre-Atlantique, 79 % des cadres français les considèrent légitimes. Surtout, 90 % souhaitent que ces politiques soient maintenues ou renforcées, notamment autour de l’égalité femmes-hommes.
Les entreprises françaises comptent très majoritairement maintenir leurs politiques en la matière, voire les développer (47 % pour les ETI et grandes entreprises, 29 % des PME et 19 % des TPE).
Malgré ces bouleversements, 65 % des cadres se déclarent sereins face aux changements à venir. Cette sérénité s’explique en partie par leur expérience : 63 % jugent que leur métier a changé ces dernières années et 61 % anticipent d’autres changements.
Mais cette confiance s’accompagne d’une demande forte : 92 % estiment qu’il est capital que toutes les parties prenantes s’engagent. « Ce besoin de collectif est ressorti de manière très forte pour éviter les effets pervers de ces transformations », souligne Laetitia Niaudeau. Les deux tiers des cadres considèrent notamment que les syndicats ont un rôle à jouer.
Le degré de préparation des entreprises reste toutefois inégal : 44 % des TPE et 46 % des PME ont déjà engagé des réflexions sur la transformation numérique, contre 60 % pour les grandes entreprises. Un décalage qui appelle, selon l’Apec, une mobilisation de l’ensemble des acteurs – entreprises, syndicats et pouvoirs publics.
| « Il n’y a pas d’épidémie de la flegme en France » |
|---|
|
Lors du colloque organisé par l’Apec, Dominique Méda, sociologue, et Antoine Foucher, président du cabinet Quintet et ancien directeur de cabinet au ministère du travail, ont livré leur analyse face aux défis à relever. Pour Antoine Foucher, la génération actuelle fait face à trois bouleversements majeurs : écologique, démographique et numérique ». Le choc démographique, avec une baisse continue de la population active (1,27 actif pour un retraité), redistribue les cartes du rapport de force sur le marché du travail. Le numérique, notamment l’intelligence artificielle, marque la première révolution industrielle qui touche les cols blancs. Et l’écologie impose une redéfinition des priorités économiques. S’agissant du nouveau rapport au travail, cet expert balaie les clichés sur une prétendue démobilisation des actifs : « il n’y a pas d’épidémie de la flegme en France ». « Le taux d’emploi atteint 69 %, un record depuis 50 ans, notamment grâce à l’entrée massive des femmes sur le marché du travail ». Pourtant, derrière cette vitalité apparente, se cache un profond malaise. Dominique Méda souligne l’ampleur du fossé entre les attentes des jeunes et la réalité du marché du travail. « Plus d’un tiers des jeunes souhaitent se reconvertir », alerte-t-elle, citant les enquêtes européennes et les données de la Dares qui indiquent que 37 % des actifs ne se sentent pas capables d’aller jusqu’à la retraite. Les conditions de travail, le manque de reconnaissance, et une perte de sens alimentent cette désillusion. La sociologue liste trois scénarios pour inverser la tendance : le démantèlement du droit du travail, la révolution technologique et une reconversion écologique. Elle rejette le premier, jugé inefficace pour créer des emplois ou améliorer les conditions de travail. Quant à la technologie, elle appelle à la prudence : « 34 % des emplois pourraient disparaître, notamment ceux des femmes et des employés de bureau », prévient-elle, dénonçant une absence de débat démocratique sur ces transformations. Vers un avenir « désirable » ?
Face à ces défis, les deux experts convergent sur la nécessité d’un projet collectif. Dominique Méda plaide pour une reconversion écologique du travail, qui redonne la parole aux salariés et favorise la codétermination. « Il faut démocratiser les environnements de travail », insiste-t-elle, pour sortir du sentiment de mépris et de perte de sens.
Antoine Foucher, lui, esquisse les contours d’un idéal du travail au XXIe siècle : un travail qui épanouit, améliore la vie, et dont on peut être fier. Il propose une GPEC nationale pour former 300 000 personnes par an à des métiers d’intérêt général, financée par un abondement du compte personnel de formation et une désindexation partielle des retraites. Une mesure concrète sur laquelle les partenaires sociaux ont commencé à plancher avec l’accord national interprofessionnel sur les reconversions professionnelles du 25 juin dernier, figurant dans le projet de loi seniors toujours en cours d’examen.
|