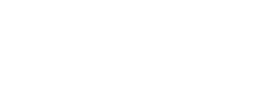Introduite en 2008 pour assouplir les séparations employeur-salarié, la rupture conventionnelle devait simplifier la fin des contrats à durée indéterminée tout en préservant les droits des deux parties. 17 ans plus tard, ce dispositif, qui représente désormais 15 à 18 % de l’ensemble des ruptures de CDI, produit des effets inattendus, selon une note rédigée par les économistes Pauline Carry, professeure à l’université de Princeton (États-Unis) et Benjamin Schoefer, professeur à l’université de Berkeley (Etats-Uni), pour l’Institut des politiques publiques, et dévoilée hier.
► Le périmètre de l’étude est restreint aux entreprises du secteur privé ayant au moins 10 salariés et à la période 2002-2014, soit quelques années autour de la mise en place du dispositif. L’enquête auprès des DRH a, elle, été réalisée en 2024.
Le principe semblait séduisant : permettre à l’employeur et au salarié de se mettre d’accord sur la fin d’un CDI sans avoir à justifier de motif, tout en garantissant l’éligibilité à l’assurance chômage. Plus flexible qu’un licenciement pour motif personnel – qui nécessite une cause réelle et sérieuse et donne lieu à un contentieux dans 25 % des cas -, la rupture conventionnelle offre la possibilité de négocier la date de départ et l’indemnité de rupture.
Pourtant, contrairement aux attentes, seuls 12 % des licenciements ont été convertis en ruptures conventionnelles. Autrement dit, environ 24 % des ruptures conventionnelles correspondent à d’anciens licenciements potentiels, tandis que 76 % ont une autre origine. Plus surprenant encore : le nombre de litiges aux prud’hommes suite à un licenciement n’a pas diminué après l’introduction du dispositif, restant stable autour de 120 000 à 130 000 cas annuels.
Pour comprendre cette faible conversion, les chercheurs ont interrogé 210 DRH. Trois facteurs principaux émergent. D’abord, l’hostilité entre employeur et salarié, citée par 60 % des DRH comme frein majeur à la négociation d’une rupture conventionnelle. Ensuite, l’usage du licenciement comme outil disciplinaire, mentionné par 53 % des répondants qui cherchent ainsi à décourager certains comportements. Enfin, les divergences sur l’issue probable d’un contentieux prud’homal, évoquées par 47 % des DRH.
Résultat : ce sont les licenciements les moins conflictuels qui se transforment en ruptures conventionnelles. L’étude révèle notamment que 37 % des licenciements survenant trois ans avant l’âge de départ à la retraite sont convertis en ruptures conventionnelles – un taux bien supérieur à la moyenne de 12 %.
Le constat le plus préoccupant concerne les démissions. Après l’introduction de la rupture conventionnelle, leur nombre a diminué de 19 %. Une enquête réalisée en 2012 auprès de salariés révèle que près de 40 % de ceux ayant signé une rupture conventionnelle déclarent qu’ils auraient démissionné en l’absence de ce dispositif – contre seulement 22 % estimant qu’ils auraient été licenciés.
Cette transformation a un coût significatif pour les finances publiques : alors qu’une démission classique n’ouvre pas droit à l’assurance chômage, 80 à 95 % des salariés ayant signé une rupture conventionnelle perçoivent des allocations. Et environ 80 % sont encore en recherche d’emploi 20 jours après leur départ, ce qui suggère que ces « démissions remplacées » ne conduisent pas à des transitions directes d’emploi à emploi.
L’étude met également en lumière une disparité sociale. Ce sont principalement les salariés occupant des positions stratégiques qui parviennent à négocier une rupture conventionnelle : 19 % des séparations de cadres prennent cette forme, contre 11 % seulement chez les ouvriers et employés. Ces cadres, aux salaires plus élevés, génèrent un « coût accru pour l’assurance chômage ».
Avec près de 500 000 ruptures conventionnelles conclues en 2024, l’enjeu de politique publique est considérable. Le dispositif, conçu pour faciliter les séparations à l’amiable et réduire les contentieux, se révèle finalement être un « mécanisme de transformation des démissions en départs indemnisés », sans réellement apaiser les licenciements conflictuels.
Une situation qui a amené le précédent et l’actuel gouvernement à souhaiter revenir sur ses modalités. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2026 prévoit, en effet, d’alourdir la contribution patronale des indemnités de rupture conventionnelle, avec un taux passant de 30 % à 40 %. Or, les parlementaires, se sont opposés à cette mesure en commission des affaires sociales, le 27 octobre. Un amendement, déposé par des députés de gauche, issus principalement des groupes La France Insoumise et Les écologistes, visant à maintenir le taux de contribution patronale à 30 % a été adopté par les députés en commission. L’amendement précise que si « le dispositif des ruptures conventionnelles peut parfois servir de détournement des procédures de licenciement collectif, il reste aujourd’hui un des rares leviers permettant aux salariés de négocier une sortie de leur emploi avec un minimum de protection et de reconnaissance financière ». Cependant, en séance publique, les députés ont voté pour une augmentation du taux de 30 % à 40 % le 6 novembre dernier.