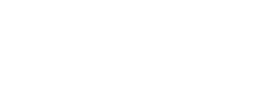Le contentieux de la licéité de critères d’évaluation des salariés est un contentieux suffisamment rare pour que les décisions de justice rendues en la matière soient remarquées, en particulier celles de la Cour de cassation. La Haute Cour a eu l’occasion, il y a une dizaine d’années, d’affirmer que les méthodes d’évaluation des salariés doivent reposer sur des critères précis, objectifs et pertinents au regard de la finalité poursuivie (arrêt du 14 février 2015). Elle confirme cette solution dans un arrêt du 15 octobre 2025, promis à une large publication, qui fournit également une illustration de la confrontation de ce principe à des critères d’évaluation du comportement.
Dans la présente affaire, à la suite de l’action en justice d’un syndicat, les juges du fond ont déclaré illicite dans son intégralité un dispositif d’évaluation nommé « procédure d’entretien de développement individuel » et ont interdit à l’employeur de l’utiliser.
Ce dernier contestait cette décision en faisant valoir en particulier que l’évaluation du salarié peut porter sur des éléments de la personnalité du salarié permettant d’apprécier ses facultés d’adaptation, son aptitude à s’intégrer à une équipe et à l’animer, ainsi qu’à son potentiel d’évolution, et que seule la partie du dispositif consacrée à l’évaluation des compétences comportementales du salarié étant critiquée, son interdiction en intégralité n’était pas justifiée.
La cour d’appel de Rennes a retenu en premier lieu que la partie du dispositif expressément consacrée aux « compétences comportementales groupe » ne peut pas être considérée comme accessoire ou secondaire et que l’abondance de critères et de sous-critères comportementaux pose question quant à la garantie d’un système d’évaluation suffisamment objectif et impartial. En effet, il n’est pas possible a priori de savoir dans quelle proportion exacte ils entrent en ligne de compte dans l’évaluation, ni s’il existe dans leur mise en œuvre une forme d’équilibre avec les critères d’appréciation purement techniques.
La cour d’appel a ensuite retenu que les notions d’ »optimisme », d’ »honnêteté » et de « bon sens », utilisées sous les items « engagement » et « avec simplicité », dont la connotation moralisatrice rejaillit sur la sphère personnelle des individus, apparaissent trop vagues et imprécises pour établir un lien direct, suffisant et nécessaire avec l’activité des salariés et l’appréciation de leurs compétences au travail. De plus, ces notions conduisent à une approche trop subjective de la part de l’évaluateur et manquent d’objectivité et de transparence en s’éloignant de la finalité première de l’évaluation qui est la juste mesure des aptitudes professionnelles des collaborateurs de l’entreprise.
La Haute Juridiction en conclut que la cour d’appel a pu déduire de ces énonciations et constatations que les éléments d’information ainsi recueillis ne peuvent pas constituer des critères pertinents au regard de l’évaluation des compétences professionnelles des salariés et approuve pleinement sa décision de déclarer illicite la procédure d’évaluation mise en cause.
► Ainsi, si l’évaluation de compétences comportementales n’est pas interdite par principe, c’est à la condition qu’elles soient définies de façon suffisamment précise et en lien avec l’activité professionnelle et qu’elles puissent être appréciées de manière concrète et objective.