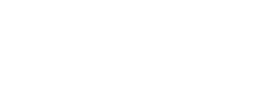Pour bénéficier des régimes social et fiscal de faveur, un régime de prévoyance/frais de santé d’entreprise doit être collectif (article L.242-1, al. 6 du code de la sécurité sociale). Les garanties proposées par le régime doivent, en effet, bénéficier à l’ensemble des salariés de l’entreprise ou, du moins, à une partie d’entre eux sous réserve qu’ils appartiennent à une ou plusieurs catégories objectives de salariés.
Cinq critères réglementaires permettent de définir ces catégories objectives. Mais il est parfois difficile de distinguer certains d’entre eux. Cette distinction est pourtant fondamentale parce que les critères n’offrent pas tous le même niveau de sécurité juridique à l’employeur. Certains d’entre eux instaurent, au profit de l’employeur, une présomption du caractère collectif du régime mis en place ; les autres non.
Un arrêt du 16 octobre 2025 offre à la Cour de cassation l’occasion de mieux appréhender la distinction faite entre le critère n° 3 et le critère n° 4, qui s’appuient, tous deux, sur les textes conventionnels de branche.
Les catégories objectives de salariés peuvent être définies par référence aux critères suivants (article R.242-1-1 du code de la sécurité sociale) :
- critère n° 1 : l’appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres (résultant aujourd’hui des définitions de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 sur la prévoyance des cadres mais, à l’époque des faits, des définitions de la convention collective nationale de retraite de prévoyance des cadres de 1947 et de son annexe I) ;
- critère n° 2 : un seuil de rémunération déterminé à partir du plafond de la sécurité sociale (à l’époque des faits, ce seuil était déterminé à partir de l’une des limites inférieures aux tranches Agirc-Arrco des retraites complémentaires) ;
- critère n° 3 : la place dans les classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels ;
- critère n° 4 : le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d’autonomie ou l’ancienneté dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées parles conventions ou les accords susvisés ;
- critère n° 5 : l’appartenance aux catégories définies à partir des usages en vigueur dans la profession.
Les critères susvisés peuvent être combinés entre eux ou être appliqués de manière alternative.
L’utilisation des critères n° 1, n° 2 et n° 3 (ou leur combinaison) laisse présumer que les garanties de prévoyance lourde offertes aux salariés relevant d’une même catégorie les placent dans une situation identique et que le régime mis en place revêt un caractère collectif à même d’ouvrir droit aux exonérations sociales.
L’utilisation des seuls critères n° 1 et n° 2 (ou leur combinaison) permet le bénéfice de cette présomption pour les garanties « frais de santé » (article R.242-1-2 du code de la sécurité sociale). Le jeu de cette présomption fait perdre à l’Urssaf tout droit d’appréciation sur le caractère objectif des catégories retenues et le caractère collectif du régime mis en place.
► Pour bénéficier de cette présomption, en ce qui concerne le critère n° 3 pour la prévoyance et les critères n° 1 et n° 2 pour les frais de santé, il faut aussi que l’ensemble des salariés de l’entreprise soit couvert au titre du même risque.
En revanche, le recours aux critères n° 4 (catégories de salariés selon les sous-catégories fixées par les conventions collectives) et/ou n° 5 ne fait pas jouer la présomption.
L’employeur doit être en mesure de justifier que les catégories retenues selon ces critères permettent de couvrir les salariés de façon identique.
Distinguer les critères n° 3 et n° 4 est donc un enjeu fondamental pour la sécurité juridique du régime. Or, cette distinction n’est pas aisée, comme en témoigne cette affaire.
En l’espèce, une entreprise appartenant au secteur de la métallurgie a mis en place un régime de prévoyance collectif au bénéfice de quatre catégories de salariés :
- catégorie 1 : le personnel « ouvriers » de niveau I à IV (coefficient 140 à 285) et « employés » de niveau I à V (coefficient 140 à 365) ;
- catégorie 2 : le personnel « agents de maîtrise » de niveau III à V (coefficient 215 à 305) ;
- catégorie 3 : le personnel « assimilé cadres – article 36 » de niveau V (coefficient 335 à 365) et « cadres » de position I et IIIB ;
- catégorie 4 : le personnel « cadres » de position IIIC.
► A l’époque des faits, existaient effectivement des accords collectifs de branche différents pour les non-cadres et les ingénieurs et cadres. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. Une nouvelle convention collective du 7 février 2022 regroupe 25 accords nationaux, 76 conventions collectives territoriales, la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ainsi que la convention collective de la sidérurgie.
L’entreprise est contrôlée par l’Urssaf pour l’année 2016. Pour l’organisme de recouvrement, les contributions patronales finançant le régime de prévoyance ne peuvent pas bénéficier de l’exclusion de l’assiette des cotisations sociales dans la mesure où le régime ne respecte pas le caractère collectif des garanties mises en oeuvre.
L’entreprise conteste le redressement en justice.
Elle soutient que les catégories de salariés retenues procédaient à la fois :
- d’une distinction « cadres/non-cadres » au titre du critère n° 1 ;
- et d’une distinction en fonction de la place dans les classifications professionnelles définies par les accords nationaux de la métallurgie pour les non-cadres et de la CCN des ingénieurs et cadres de la métallurgie pour les cadres, conformément au critère n°3.
Le caractère collectif des garanties couvertes par le régime de prévoyance est selon elle, de ce fait, présumé.
Mais les juges du fond ne sont pas du même avis et le redressement est confirmé.
Constatant que les accords nationaux relatifs à la classification des emplois de la métallurgie distinguent quatre catégories de personnel différentes de celles retenues par le régime (à savoir, les ouvriers, les administratifs et techniciens, les agents de maîtrise et, dernière catégorie, les ingénieurs et cadres), ils considèrent que l’entreprise a procédé à une distinction à l’intérieur de la catégorie des ingénieurs et cadres. Elle n’a donc pas appliqué le critère n° 3 mais bien le critère n° 4 qui ne lui permet pas de se prévaloir de la présomption prévue à l’article R. 242-1-2. Et comme elle ne justifie pas du caractère collectif du régime, le redressement est justifié.
L’entreprise se pourvoit en cassation.
Dans son arrêt du 16 octobre 2025, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Pour elle, « dès lors qu’il contient une distinction des grands ensembles d’emploi qui y sont identifiés », le critère réglementaire n° 3 « doit s’entendre du premier niveau de classification des salariés défini par les conventions de branche (ou les accords professionnels et interprofessionnels) ».
« Tous les niveaux inférieurs, situés immédiatement après ce premier niveau, doivent être considérés comme des sous-catégories relevant du critère n° 4 ».
Notons qu’à l’appui de son pourvoi, l’entreprise arguait d’une modification textuelle de la réglementation pouvant laisser penser que la prise en compte systématique du premier niveau de la grille de classification ne s’imposait plus. En effet, l’article, dans sa version antérieure au décret du 8 juillet 2014, visait à son 3°, « l’appartenance aux catégories et classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels ».
Depuis le 11 juillet 2014 (date d’entrée en vigueur du décret du 8 juillet 2014), le 3° de l’article R. 242-1-1 vise « la place dans les classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels ».
Pour les juges du fond comme pour l’administration, la modification rédactionnelle de cet article ne visait nullement à permettre de définir, au-delà des grands ensembles d’emplois identifiés dans la classification, une catégorie objective de salariés en s’appuyant sur les subdivisions des accords conventionnels fondées sur le niveau de responsabilité, le type de fonction ou le degré d’autonomie ou l’ancienneté dans le travail des salariés.
► En son temps, l’Acoss (Caisse centrale de la sécurité sociale) considérait que les catégories objectives de salariés définis sur la base du critère n° 3 doivent renvoyer à des ensembles de métiers ou de fonctions « structurantes » pour la branche et les entreprises (lettre-circulaire Acoss n° 2014-0000002, 4 février 2014 ; lettre-circulaire Acoss n° 2015-0000045, 12 août 2015). Cette position a été reprise par le Boss : seuls les niveaux de classification permettant d’identifier une catégorie professionnelle peuvent être retenus. Si au sein d’une convention ou d’un accord professionnel, le premier niveau de subdivision relatif à la classification ne permet pas de constituer une catégorie car il ne repose pas sur une distinction des fonctions exercées par les salariés, il faut rechercher dans la convention ou l’accord l’existence d’une distinction plus structurante (Boss-PSC-1130). Tout en reprenant la position de l’Acoss, le Boss fait à nouveau référence au premier niveau de classification des salariés. L’arrêt du 16 octobre 2025 conforte donc la position administrative.
Une position validée par la Cour de cassation.
L’entreprise n’aurait pas dû créer une catégorie regroupant les salariés assimilés cadres de niveau V et les cadres de position I à IIIB et une catégorie particulière pour les cadres de position IIIC. Pour se prévaloir du critère n° 3, elle aurait dû regrouper tous les salariés cadres au sein d’une seule catégorie.