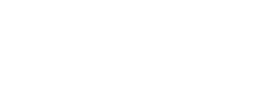Est-ce la fin du contentieux ou une décision provisoire ? Le 11 septembre 2025, la commission des sanctions de la H2A a décidé que la législation française qui interdit (à deux exceptions près) aux commissaires aux comptes d’exercer des activités commerciales est illégale. Conséquence : elle a mis ![]() hors de cause Christian Latouche dans l’affaire qui l’oppose à la H2A — à l’époque, l’affaire a été initiée par le H3C via sa formation sur les cas individuels. Cette formation demandait que le fondateur et propriétaire du groupe Fiducial soit radié de la liste des commissaires aux comptes pour avoir exercé des activités commerciales interdites par le droit français.
hors de cause Christian Latouche dans l’affaire qui l’oppose à la H2A — à l’époque, l’affaire a été initiée par le H3C via sa formation sur les cas individuels. Cette formation demandait que le fondateur et propriétaire du groupe Fiducial soit radié de la liste des commissaires aux comptes pour avoir exercé des activités commerciales interdites par le droit français.
Mais l’affaire n’est peut-être pas terminée. Car l’autorité de contrôle de l’audit légal peut, dans un délai de deux mois, contester ce verdict devant le Conseil d’Etat. A la date du 7 octobre 2025, elle n’avait pas décidé si elle allait attaquer la position de la commission des sanctions. Quels enseignements tirer de cette affaire à ce stade ? Voici quelques éléments de réponse et un rappel des faits.
– 13 octobre 2022 : la formation du H3C sur les cas individuels engage une procédure de sanction à l’encontre de Christian Latouche (lire notre article).
Cette formation considère que le propriétaire de Fiducial a exercé, directement ou indirectement, depuis le 3 janvier 2016, des activités commerciales incompatibles avec le commissariat aux comptes (cf article L 820-10 ; désormais article L 821-27). Rappelons qu’avant la loi Pacte de 2019, les fonctions de Cac étaient incompatibles avec toute activité commerciale, qu’elle soit exercée directement ou par personne interposée. Depuis cette loi, deux exceptions sont permises : dans le cadre d’activités accessoires à la profession d’expert-comptable et dans celui d’activités accessoires exercées par une société pluri-professionnelle d’exercice.
Cette formation du H3C lui reproche d’avoir exercé, au travers de deux sociétés de Fiducial, les activités commerciales suivantes qui ne sont pas accessoires à la profession d’expert-comptable : prestations de sécurité, vente de fournitures et de mobilier de bureau, activité d’agent immobilier et de gestion de sociétés civiles de placement immobilier, activité bancaire et prestations dans le secteur des médias. Le rapporteur général de cette formation du H3C demande ainsi que Christian Latouche soit radié de la liste des commissaires aux comptes et qu’il lui soit infligé une sanction pécuniaire de 250 000 euros. Le propriétaire de Fiducial répond que la réglementation française est illégale sur ce sujet. Il demande à être mis hors de cause.
– 25 mai 2023 : la formation restreinte du H3C demande l’interprétation de la Cour de justice de l’Union européenne (lire notre article).
Sur le fond, la formation restreinte du H3C demande à la CJUE si le cadre français qui s’impose au Cac en matière d’activités commerciales — c’est-à-dire l’interdiciton d’exercer des activités commerciales à deux exceptions près — est légal. La question juridique qui se pose tourne autour de l’articulation entre la directive sur les services ( directive 2006/123/CE) et le cadre européen en matière d’audit légal des comptes (directive 2006/43/CE sur le contrôle légal des comptes et règlement 537/204 sur le contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public (EIP)).
La directive sur les services prévoit comme principe le droit des prestataires de services d’exercer plusieurs activités (article 25). Toutefois, les Etats membres peuvent (sous conditions) limiter voire interdire la fourniture d’activités pluridisciplinaires. C’est notamment le cas pour les professions réglementées « dans la mesure où cela est justifié pour garantir le respect de règles de déontologie différentes en raison de la spécificité de chaque profession, et nécessaire pour garantir l’indépendance et l’impartialité de ces professions ». De son côté, le cadre européen sur le contrôle légal des comptes ne traite pas explicitement le sujet des activités commerciales. Toutefois, la directive sur le contrôle légal des comptes impose des exigences en matière d’audit légal des comptes et donne la possibilité aux Etats membres d’en prévoir qui soient plus rigoureuses.
– 13 juin 2024 : l’avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) considère que la réglementation française est en principe illégale au regard du droit de l’Union européenne (lire notre article).
Selon l’avis — non contraignant — de l’avocat général de la CJUE, la réglementation française interdit de façon quasi absolue au commissaire aux comptes d’exercer des activités commerciales. Il se fonde notamment sur les arguments suivants :
1) les États membres sont tenus de respecter les dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) relatives tant à la liberté d’établissement qu’à la libre prestation de services, prévues respectivement aux articles 49 et 56 du TFUE ;
2) la directive 2006/123 vise précisément à éliminer les restrictions à la liberté d’établissement et à la libre circulation des services entre les États membres ;
3) il n’y a pas de conflit entre la directive services et le cadre européen sur le contrôle légal des comptes — dans le cas contraire, c’est le cadre européen sur le contrôle légal des comptes qui serait applicable — mais plutôt une relation de complémentarité. Ce qui revient à dire que pour être légale, la réglementation française qui interdit, à deux exceptions près, au commissaire aux comptes d’exercer des activités commerciales doit d’abord être justifiée par une impérieuse raison d’intérêt général. Or, l’avocat général émet de gros doutes car la réglementation française interdit au Cac de fournir certains services même à des entités dont il ne contrôle pas les comptes. Pour lui, l’indépendance de ce professionnel n’est pas en danger lorsqu’il fournit des activités commerciales à une entité dont il ne contrôle pas les comptes. De plus, l’interdiction générale d’activités commerciales lui semble disproportionnée et aller au-delà de l’objectif visant à préserver l’indépendance et l’objectivité des contrôleurs légaux des comptes.
– 26 septembre 2024 : la CJUE ne répond pas aux questions qui lui sont posées (lire notre article)
La Cour de justice de l’Union européenne juge qu’elle ne peut pas répondre — à ce stade — aux deux questions qui lui sont posées afin de savoir si le droit français qui interdit au commissaire aux comptes, aux deux exceptions près, d’exercer des activités commerciales respecte le droit de l’Union européenne. La raison : la formation restreinte du H3C, à l’origine des questions, exerce une activité administrative et non juridictionnelle. Conséquence : sa demande est irrecevable.
– 11 septembre 2025 : la commission des sanctions met hors de cause Christian Latouche
Les arguments de la H2A n’ont pas convaincu la commission des sanctions. Quels étaient-ils ? Pour justifier la législation française sur ce sujet, la H2A avance notamment que les Etats membres peuvent apporter des restrictions à l’article 25 de la directive services si elles sont justifiées par la nécessité d’assurer le respect des règles de déontologie, afin de garantir l’indépendance et l’impartialité de ces professions. Pour l’autorité de contrôle de l’audit, « la restriction [prévue au 3° de l’article L 821-27 du code de commerce] est justifiée en ce qu’elle vise à garantir le respect des règles de déontologie propres à la profession de commissaire aux comptes alors que les opérations commerciales ne sont soumises à aucune règle déontologique et que les règles déontologiques auxquelles sont soumis les commissaires aux comptes visent à garantir leur impartialité dans l’exercice de leur activité professionnelle mais également leur indépendance tant à l’occasion qu’en dehors de leur exercice ». Elle ajoute que « cette restriction est strictement nécessaire à la réalisation des objectifs d’indépendance et de protection de l’intérêt général visées par la directive 2006/43 et le règlement 537/2014 et elle ménage un juste équilibre entre la liberté d’entreprendre du commissaire aux comptes et la nécessité de protéger l’intérêt général ».
Cette argumentation n’a donc pas convaincu la commission des sanctions. Pour elle, c’est la directive services, qui répond aux objectifs des articles 49 et 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui prime. Ce qui revient à dire que les restrictions à la liberté des prestations de service des professions réglementées telles que les commissaires aux comptes prévues à l’article 25 de la directive services ne sont permises que pour garantir leur indépendance et leur impartialité. « Une règle d’un État membre, laquelle interdit aux contrôleurs des comptes d’exercer toute autre activité commerciale, est, en soi, de nature à porter atteinte à la liberté de déplacement des contrôleurs des autres États membres », résume la commission des sanctions qui ajoute que « la législation française a inversé la proposition de l’article 25 de la directive 2006/123 en posant comme règle générale une restriction au libre exercice des activités des commissaires aux comptes et des activités pluridisciplinaires par les commissaires aux comptes ».
Et pour la commission des sanctions, ces restrictions ne sont pas justifiées par une impérieuse raison d’intérêt général. D’une part, parce que la législation nationale ne distingue pas selon que l’activité commerciale prohibée concerne l’entité auditée ou non — alors que la cadre européen sur le contrôle légal des comptes admet des restrictions pour garantir l’indépendance et l’impartialité du Cac au regard de l’entité auditée. D’autre part, la réglementation française impose, via l’article R 821-82 du code de commerce et le code de déontologie des Cac, des dispositions destinées à assurer l’indépendance et l’impartialité du professionel vis-à-vis de l’entité auditée. Bref, pour la commission des sanctions, la législation française sur ce sujet est disproportionnée et va au-delà de l’objectif poursuivi, qui vise à préserver l’indépendance et l’impartialité du commissaire aux comptes.
A l’heure où nous écrivons ces lignes, c’est-à-dire le 7 octobre 2025, nous ne savons pas si ce verdict met un point final au contentieux. En effet, la H2A n’a pas décidé si elle allait le contester devant le Conseil d’Etat — elle dispose de deux mois pour le faire. Dans l’hypothèse où la décision de la commission des sanctions mettrait un terme à cette affaire, le législateur français serait probablement obligé de modifier le fameux article L 821-27 du code de commerce. Mais si la H2A conteste, il sera possible qu’une incertitude juridique demeure tant que le Conseil d’Etat n’aura pas rendu son verdict. Toutefois, le Conseil d’Etat pourrait décider d’interroger au préalable la CJUE. Un tel scénario rallongerait d’autant plus le délai de traitement de l’affaire mais permettrait à la plus haute juridiction administrative d’y voir plus clair si elle en avait besoin. Il est toutefois intéressant de relever que la conclusion émise par l’avocat général de la CJUE coïncide dans les grandes lignes avec celle de la commission des sanctions. Pour lui, la législation française est en principe illégale car elle semble disproportionnée et aller au-delà de l’objectif visant à préserver l’indépendance et l’objectivité des contrôleurs légaux des comptes.