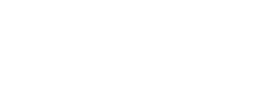La commission des affaires sociales du Sénat a organisé, mercredi 1er octobre 2025, des auditions sur les deux nouveaux arrêts du 10 septembre 2025 relatifs à l’alignement de la jurisprudence de la Cour de cassation sur la jurisprudence européenne en matière de congés payés. L’occasion pour la Cour de cassation de justifier les solutions retenues et, pour les représentants des entreprises, d’exprimer leurs inquiétudes et interrogations.
Jean-Guy Huglo, conseiller doyen de la chambre sociale de la Cour de cassation, s’est attelé à « défendre » les arrêts du 10 septembre 2025 face aux critiques qu’ils ont pu susciter. « Comme personne ne nous a posé la question jusqu’à présent, évidemment on n’avait pas eu l’occasion de se prononcer de nouveau sur la question [depuis l’arrêt de 1996]. Quand nous sommes saisis d’un pourvoi, nous n’avons pas le choix, nous sommes obligés de statuer », a rappelé le magistrat. Je suis parfois irrité lorsque je vois les commentaires des journalistes disant que la chambre sociale s’est emparée de tel sujet. On ne peut pas s’emparer d’un sujet puisqu’il faut attendre un pourvoi et un moyen du pourvoi qui nous pose la question et, une fois que la question nous est posée, il y a la prohibition du déni de justice qui est un crime (…) On ne peut pas refuser de statuer même si la question est un peu délicate ».
Une fois cette mise au point faite, le conseiller à la chambre sociale est entré dans le vif du sujet. « Comme il n’y a aucun texte sur le sujet dans le code du travail (…), nous n’avions pas écarté l’application d’un texte du code du travail (…) Notre solution des années 90 étant purement jurisprudentielle » (…) De plus, nous sommes tenus d’une interprétation conforme de notre droit français au regard de la directive de 2003 sur les congés payés. Il nous fallait évoluer sur notre jurisprudence ».
Il a également tenu à rappeler que « depuis un an, le site du ministère du travail recommande aux entreprises de ne plus faire application de la jurisprudence de la chambre sociale traditionnelle mais de faire application de la jurisprudence de la CJUE » et que, par ailleurs, « une procédure en manquement a commencé à être engagée par la Commission européenne le 18 juin dernier en adressant une mise en demeure au gouvernement français (…) Nous n’avions aucune marge de manoeuvre ».
Le Directeur général du travail, Pierre Ramain, a tenu à rappeler que si les arrêts du 10 septembre 2025 ont statué sur des faits antérieurs à la loi DDADUE du 22 avril 2024, cette loi apportait déjà des réponses au cas où le salarié tombe malade pendant ses congés payés, permettant à un salarié qui est dans l’impossibilité de prendre ses congés payés pour cause de maladie de bénéficier d’une période de report « sans distinction de date à laquelle l’arrêt intervient y compris pendant les congés payés ».
Après avoir rappelé l’obligation pour les juges français de se mettre en conformité avec la jurisprudence européenne, Jean-Guy Huglo a détaillé les garde-fous qui ont été posés dans l’arrêt du 10 septembre 2025 :
- le salarié doit avoir notifié son arrêt maladie à son employeur durant ces congés payés (dans un délai de 48 heures en principe) ce qui permet à l’employeur de procéder, s’il le souhaite, à une contre-visite ;
- ces arrêts ont été publiés en septembre laissant ainsi aux entreprises le temps de s’accoutumer à la nouvelle règle ;
- le salarié devant produire un arrêt maladie, les contentieux rétroactifs seront « rarissimes », ce que confirme le Directeur général du travail : ces arrêts n’entraîneront pas « de situations antérieures lourdes à régler contrairement aux arrêts de 2023 ».
Revenant plus rapidement sur le 2e arrêt du 10 septembre 2025 sur les heures supplémentaires, Jean-Guy Huglo a rappelé que la CJUE a condamné dans un arrêt du 13 janvier 2022 le dispositif consistant à ne pas tenir compte des congés payés de la semaine pour décompter les heures supplémentaires, cela dissuadant le salarié de prendre ses congés payés. « Nous avions un article du code du travail qui est incompatible, partiellement en tous cas, avec la directive de 2003 tel qu’interprétée par la CJUE dans son arrêt du 13 janvier 2022 ».
« L’arrêt ne parle que du décompte hebdomadaire. Et, en pratique les heures supplémentaires dites structurelles, celles effectuées chaque semaine par un salarié car le régime horaire est de 38 heures, 39 heures, pas de 35 heures, ne sont pas concernées par cette jurisprudence », a expliqué Pierre Ramain. En pratique, les logiciels de paie sont déjà configurés pour que ces heures supplémentaires soient majorées. « Ce sont uniquement les heures supplémentaires ponctuelles, qui sont en régime de décompte hebdomadaire, sur lesquelles la jurisprudence aura un impact direct ».
Pour conclure sur ces deux arrêts, Jean-Guy Huglo a tenu à rassurer les entreprises : « ce sont les dernières incompatibilités du droit français avec le droit des congés payés de l’UE ».
La parole a ensuite été donnée aux représentants des entreprises. « Nous ne contestons pas le raisonnement juridique qui a conduit à ces arrêts, admet France Henry-Labordère, directrice générale adjointe du Medef responsable du pôle social. En revanche (…) ces arrêts sont très mal perçus par les entreprises car ils s’inscrivent à la suite des arrêts du 13 septembre 2023 qui avaient donné lieu à la loi DDADUE de 2024 ». Loi « qui déjà avait envoyé un premier signal négatif aux chefs d’entreprise s’agissant de la valeur travail dans un environnement économique concurrentiel ». Par ailleurs, a souligné la représentante du Medef, ces arrêts s’inscrivent dans un contexte qu’on connait sur l’augmentation très importante de l’absentéisme constatée depuis la fin du Covid ».
A cela s’ajoute, « en France, une règlementation sur le temps de travail très exigeante – on a les 35 heures – mais au-delà des 35 heures, on a sur l’ensemble du champ du temps de travail toute une série de règles qui sont extrêmement contraignantes [temps partiel, travail dominical, travail de nuit] », énumère France Henry-Labordère. « Une législation proprement française et qui – bien évidemment – s’ajoute aux règles posées par l’UE et font que ça devient extrêmement compliqué pour les entreprises de rester compétitives ».
La représentante du Medef a ensuite détaillé les premières questions qui remontent de la part des entreprises :
- quel est le délai au sein duquel le salarié doit communiquer son arrêt de travail ? Est-ce bien 48 heures ? ;
- quid des salariés qui sont à l’étranger pendant leurs congés payés et qui tombent malades ? quid de la contre-visite dans ce cas ?
- qu’en est-il des congés de fractionnement ?
- la jurisprudence sur les heures supplémentaires s’applique-t-elle aussi à la 5e semaine de congés payés ? Aux heures complémentaires dans le cadre du temps partiel ? Qu’en est-il des autres dispositifs de décompte du temps de travail ?
Sur la question de la 5e semaine de congés payés, Jean-Guy Huglo a aussitôt répondu « qu’on ne peut pas réécrire le texte en faisant une distinction entre la 4e et la 5e semaine de congés payés comme on a voulu le faire dans le cadre de la loi de 2023. La jurisprudence a donc vocation à s’appliquer à la 5e semaine ».
Le vice-président de la CPME en charge des affaires sociales, Eric Chevé, souhaite qu’il soit impossible de demander un arrêt de travail en ligne « car pendant les congés ça va être facile ». Laurence Breton-Kueny, vice-présidente déléguée de l’ANDRH et DRH d’Afnor, a renchéri se disant « très sensible à la traçabilité et à la lutte renforcée contre les arrêts en ligne ». Elle rejoint également le Medef sur la possibilité de pratiquer des contrôles à l’étranger. « Si on ne peut pas avoir des contrôles que ce soit de la CPAM et encore moins de nous, il ne faut pas prendre en compte ces arrêts maladie ».
Au-delà de ces interrogations, les représentants des entreprises estiment que le système français ne peut pas rester en l’état. « Ces nouveaux arrêts imposent de réfléchir globalement à notre législation sur le temps de travail », a indiqué la représentante du Medef, rejointe en cela par le représentant de la CPME. « Le droit devient petit à petit incompréhensible pour le commun des mortels. On est face à une situation où le salarié moyen, le chef d’entreprise moyen ne comprennent plus rien. Nous allons faire des propositions pour simplifier le droit », évoquant même la négociation d’un accord national professionnel. Proposition saisie au vol par Pierre Ramain. « On est tout à fait preneurs des pistes de travail que les organisations professionnelles pourraient avoir pour essayer de limiter l’impact ou mieux accompagner la mise en oeuvre de ces évolutions. S’il y a des marges qui permettent de mieux encadrer l’application de ces principes dans le contexte de l’évolution des indemnités journalières et plus largement de l’absentéisme en entreprise, évidemment on est intéressés », indiquant que « le dialogue national interprofessionnel est très précieux » sur ces sujets.
La balle est donc désormais dans le camp des partenaires sociaux.