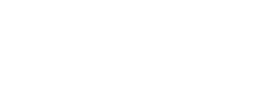François Bayrou aura dirigé le gouvernement moins de neuf mois. Nommé à Matignon le 13 décembre 2024 pour succéder à Michel Barnier, le maire de Pau a vu son exécutif chuter, avant-hier, à l’Assemblée nationale, faute d’avoir obtenu la confiance des députés qu’il avait lui-même sollicitée. Seulement 194 députés sur 573 votants ont apporté leur soutien au Premier ministre, 364 votant contre. François Bayrou a donc présenté hier sa démission au président de la République.
Cette nouvelle crise politique – la troisième depuis la dissolution de juin 2024 – plonge l’exécutif dans l’incertitude. Emmanuel Macron se trouve contraint de chercher un cinquième Premier ministre depuis le début de son second mandat, dans un contexte parlementaire toujours aussi morcelé. Cette nomination devrait intervenir dans les « tous prochains jours « , selon un communiqué de l’Elysée.
Au-delà des considérations politiciennes, cette instabilité gouvernementale compromet l’examen de plusieurs textes majeurs dans le domaine social. Projet de loi seniors, négociations sur la transparence salariale, réforme du droit du travail… Autant de dossiers qui se retrouvent gelés dans l’attente d’un nouveau locataire à Matignon.
Tour d’horizon des principaux chantiers inachevés.
La chute du gouvernement Bayrou laisse en plan un agenda législatif considérable. De nombreux décrets d’application tardent à paraître : seuls 12 % des 75 textes réglementaires nécessaires à l’application de la LFSS pour 2025 ont été publiés. De même, l’examen parlementaire du projet de loi seniors demeure inachevé. Il manque toujours l’approbation finale de l’Assemblée nationale sur le compromis trouvé en commission mixte paritaire.
D’autres projets gouvernementaux restent en souffrance, comme celui sur la simplification de la vie économique, l’autorisation de travail le 1er mai pour certains établissements, la pérennisation du contrat de professionnalisation expérimental ou encore le projet de loi de lutte contre la fraude sociale. Ce texte prévoit le partage de données entre administration fiscale et organismes sociaux, la répression des fraudes au compte professionnel de prévention (C2P) et au compte personnel de formation (CPF) ainsi que des possibilités de saisie pour certaines fraudes. Un projet que le prochain gouvernement pourrait reprendre à son compte.
L’échec des négociations sur la révision de la réforme des retraites n’avait pas découragé le gouvernement. Celui-ci s’était engagé à reprendre, dans le projet de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2026, plusieurs mesures ayant fait l’objet d’un relatif consensus.
Parmi ces ajustements figuraient l’abaissement à 66,5 ans de l’âge d’annulation de la décote ainsi que des dispositions favorables aux mères de famille : prise en compte des 23 meilleures années – au lieu de 25 – pour le calcul des pensions des femmes ayant eu deux enfants, et de 24 années pour celles qui en ont eu un. Le dispositif prévoyait également d’octroyer deux trimestres de maternité aux femmes bénéficiant du dispositif « carrières longues » tout en supprimant la surcote parentale de 5 % instaurée en 2023.
Sur le volet pénibilité, l’exécutif promettait la réintégration dans le compte ad hoc des trois critères ergonomiques supprimés en 2017 – port de charges lourdes, vibrations et postures pénibles – ainsi que l’établissement d’une cartographie des métiers pénibles pour améliorer la prévention.
Le futur gouvernement reprendra-t-il ces engagements entraînant de nouvelles dépenses dans le contexte budgétaire tendu ?
La hausse continue des dépenses de santé contraint l’exécutif à envisager des mesures d’économies d’envergure dans le prochain PLFSS. Le gouvernement Bayrou s’était fixé pour objectif de dégager un milliard d’euros sur l’objectif national des dépenses d’assurance maladie (Ondam).
Parmi les pistes à l’étude figurait un projet particulièrement sensible : le déremboursement par l’assurance maladie des arrêts de travail jusqu’à sept jours inclus.
Le départ de François Bayrou laisse en suspens un catalogue de réformes du droit du travail qui avaient fait bondir les syndicats. Dès juillet, le Premier ministre déchu avait présenté des mesures que Marylise Léon, secrétaire générale de la CFDT, avait qualifiées de « musée des horreurs ». Certaines de ces propositions étaient assorties de négociations préalables, d’autres devaient emprunter la voie des ordonnances dans une logique de « donnant-donnant » : simplifications pour les entreprises contre réduction de leurs aides publiques.
Si un gouvernement de gauche a peu de chances de reprendre ces orientations, elles pourraient, en revanche, constituer une feuille de route pour un exécutif de centre-droit.
Parmi les pistes explorées, la possibilité de monétiser la cinquième semaine de congés payés par voie d’accord collectif avait été évoquée. Plus controversé encore, l’allongement du temps de travail était envisagé selon deux modalités : faciliter le recours au forfait en jours et lever le verrou des accords de branche pour permettre aux entreprises d’augmenter la durée du travail sur des périodes pouvant aller jusqu’à trois ans.
Le gouvernement Bayrou souhaitait également assouplir par la négociation collective les règles encadrant les différents types de contrats – CDD, contrats de travail temporaire, CDI de chantier – ainsi que les périodes d’essai. Dans le même temps, il entendait renforcer les prérogatives des CSE, notamment leur information sur les aides publiques perçues par les entreprises et leur contrôle sur la mise en œuvre des plans de développement des compétences.
Sur le terrain juridique, les projets étaient tout aussi sensibles. L’exécutif envisageait de ramener de 12 à quatre-six mois le délai de contestation d’un licenciement. Il souhaitait, par ailleurs, autoriser le dépassement des 35 heures hebdomadaires pour les temps partiels sans risque de requalification du contrat.
Enfin, une révision de la rupture conventionnelle individuelle était à l’étude pour la rendre « moins favorable » aux salariés.
L’instabilité gouvernementale paralyse le dialogue social. Alors que plusieurs dossiers urgents attendent les partenaires sociaux, l’incertitude politique freine les négociations et compromet le respect d’échéances européennes contraignantes.
Les discussions sur la transparence salariale illustrent ces difficultés. Une directive européenne contraint la France à adopter de nouvelles dispositions avant juin 2026 pour obliger les entreprises à informer davantage leurs salariés sur les rémunérations internes. Cette transposition, qui entraînerait une refonte de l’Index égalité professionnelle, nécessite l’adoption d’une loi qui pourrait s’inspirer de la concertation en cours des partenaires sociaux.
D’autres dossiers réclamés par François Bayrou peinent à décoller. La suppression de deux jours fériés, censée rapporter 4 milliards d’euros au budget de l’État, n’aboutira à aucune négociation : les syndicats refusent catégoriquement d’aborder le sujet, rejoints par le Medef lui-même.
Sur l’assurance-chômage, le gouvernement réclamait aux partenaires sociaux de nouvelles économies comprises entre 600 millions et 1,1 milliard d’euros dès 2026. Là encore, les organisations syndicales se montrent peu enclines à discuter sur ces bases.
Enfin, les négociations sur le droit du travail et la négociation collective n’ont jamais démarré. Si les intentions gouvernementales étaient connues, le document d’orientation promis aux partenaires sociaux n’a jamais été transmis. Reste à savoir si le successeur de François Bayrou reprendra ces projets controversés ou s’il choisira de repartir sur de nouvelles bases.
Avec 759 décès recensés en 2023, la France peine à réduire son niveau d’accidentologie au travail. Cette situation s’accompagne d’une hausse de l’absentéisme et des dépenses d’assurance maladie, alimentant les revendications syndicales pour un retour aux CHSCT ou un renforcement des commissions santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT). Des demandes jusqu’ici écartées par les gouvernements successifs.
Face à ces enjeux, la ministre du travail, Astrid Panosyan-Bouvet, a dévoilé, en juillet, les contours du futur plan santé au travail. Parmi les mesures envisagées, elle a ciblé la refonte de la tarification des cotisations accidents du travail-maladies professionnelles, une stratégie de prévention visant dix secteurs à risque (du bâtiment aux travaux publics en passant par la métallurgie et le transport routier), une extension de la responsabilité des donneurs d’ordres ou encore un renforcement de l’obligation de formation des employeurs.
La refonte du système français d’allégements de cotisations sociales, longtemps débattue, franchit une étape décisive. Un décret du 4 septembre acte la fusion des trois dispositifs existants à compter du 1er janvier 2026, conformément aux préconisations du rapport Borzio-Wasmer d’octobre 2024. L’objectif affiché : lisser les allégements pour éviter les effets de seuil qui pénalisent les évolutions salariales. Toutefois, cette simplification s’accompagne d’un resserrement : le plafond d’éligibilité passe de 3,3 Smic actuellement à 3 Smic.
Si cette réforme était programmée, la question demeure de savoir si le prochain gouvernement entend poursuivre cette logique.
Rappelons que le gouvernement avait envisagé une conférence sociale sur cette question, le patronat étant favorable à une réforme du financement de la protection sociale.
Le montant des aides publiques aux entreprises – évalué à 211 milliards d’euros par un récent rapport sénatorial – relance le débat sur leur efficacité et leur conditionnalité.
Les sénateurs préconisent notamment une meilleure information des CSE sur l’utilisation des crédits d’impôt et autres réductions de cotisations sociales. Une transparence réclamée par les syndicats qui militent pour un encadrement plus strict de ces dispositifs.
Reste que la question de l’optimisation des aides divise les partis politiques. Si la gauche relaie les revendications syndicales, la droite y est défavorable.